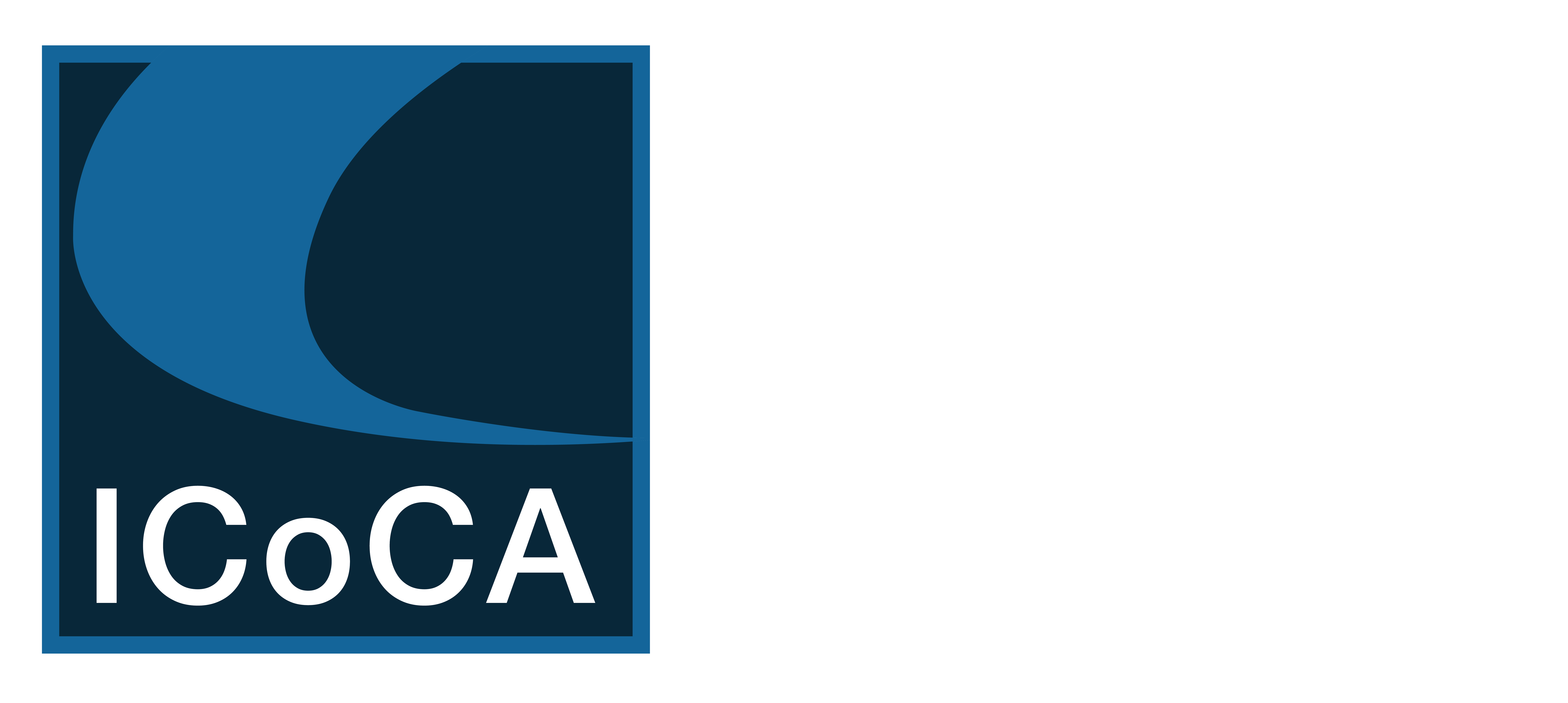UNE OPPORTUNITÉ POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES DE SÉCURITÉ DE MONTRER L’EXEMPLE
Dans cet article, Jamie Williamson, Directeur Exécutif d’ICoCA, évoque les initiatives mondiales, les défis et l’impératif de mesures proactives dans le secteur de la sécurité, suite à la participation d’ICoCA aux consultations intersessions du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée des Nations Unies chargé d’élaborer un cadre réglementaire international sur la réglementation, le contrôle et la surveillance des entreprises militaires (EMP) et de sécurité privées (ESP).
La communauté internationale accorde de plus en plus d’attention aux responsabilités et à l’obligation de rendre des comptes des entreprises militaires privées et des prestataires de services de sécurité dans le monde entier. Cela pourrait découler en partie des activités très médiatisées du « groupe Wagner » et des procès intentés contre des sociétés transnationales pour violation des droits humains par leur personnel de sécurité. Il pourrait également s’agir d’une évolution normale du niveau d’intérêt du public pour le « secteur de la sécurité », un secteur qui semble aujourd’hui omniprésent dans tous les domaines de la vie.
Des efforts nationaux et internationaux sont en cours pour renforcer les exigences en matière de rapports sur la diligence raisonnable en matière de droits humains dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Compte tenu des risques associés à l’utilisation de prestataires de services de sécurité de qualité inférieure, il est naturel de s’attendre à ce que les entreprises internationales adoptent une approche plus rigoureuse en ce qui concerne le contrôle de leurs dispositifs de sécurité (internes ou sous-traités). Une démarche qui, malheureusement, fait défaut à ce jour dans de nombreux secteurs d’activité.
 Parallèlement à ces efforts, un Groupe de Travail Intergouvernemental des Nations Unies, présidé par l’Afrique du Sud, élabore lentement mais sûrement, depuis 2017, un cadre réglementaire sur la régulation, le suivi et la surveillance des activités des entreprises militaires et de sécurité privées. ICoCA a été reconnue comme organisation experte lors de ces réunions du groupe de travail.
Parallèlement à ces efforts, un Groupe de Travail Intergouvernemental des Nations Unies, présidé par l’Afrique du Sud, élabore lentement mais sûrement, depuis 2017, un cadre réglementaire sur la régulation, le suivi et la surveillance des activités des entreprises militaires et de sécurité privées. ICoCA a été reconnue comme organisation experte lors de ces réunions du groupe de travail.
Alors que les dernières consultations intersessions, auxquelles ICoCA a participé, se sont achevées cette semaine, il est clair qu’il subsiste des désaccords fondamentaux sur un certain nombre de questions, également appelées « éléphants persistants dans la salle » au cours des échanges. Il s’agit notamment des différences et des chevauchements entre les « services de sécurité » et les « services militaires », ou de ce qui constitue les « fonctions de l’État ». Diverses perspectives ont été évoquées par les gouvernements et les ONG sur la question de savoir quels acteurs, de la sécurité ou de l’armée, doivent être réglementés, et si les États peuvent réellement limiter la capacité de leurs ressortissants à travailler dans des sociétés de sécurité à l’étranger, et si oui, dans quelles circonstances.
Cependant, tous s’accordent à reconnaître l’existence d’obligations pertinentes en vertu du droit international humanitaire et des droits humains, en vertu desquelles les États doivent mettre au pas les « sociétés militaires » privées non réglementées et les prestataires de services de sécurité privés. Il n’y a pas de vide juridique en tant que tel, et les instruments non contraignants tels que le Code de Conduite International des Prestataires de Services de Sécurité Privés, les Principes Directeurs des Nations Unies Relatifs aux Entreprises et aux Droits Humains et le Document de Montreux offrent des orientations et des normes importantes à cet égard.
Aucun consensus n’a encore été trouvé sur la question de savoir si le processus aboutira à un instrument réglementaire juridiquement contraignant ou non contraignant. Il appartiendra aux États de trancher cette question, et il faudra peut-être encore quelques sessions du groupe de travail pour trouver une solution à ce problème épineux. Ce délai pourrait faire le jeu des personnes et des entités qui ne se sentent pas pressées de permettre une plus grande surveillance du secteur de la sécurité. Mais ce serait une erreur d’accepter l’inertie dans ce domaine.
Indépendamment du résultat final sur la nature de l’instrument, je dirais qu’il existe déjà de nombreuses mesures que les fournisseurs de sécurité, leurs clients et les gouvernements peuvent et doivent prendre pour améliorer les normes au sein de l’industrie de la sécurité et renforcer la responsabilité en cas d’abus. L’une d’entre elles consiste simplement à changer l’état d’esprit collectif afin de reconnaître que toutes les parties concernées sont gagnantes si les mauvaises pratiques en matière de sécurité sont éliminées du secteur. Chaque groupe de parties prenantes peut jouer un rôle positif. Il y a toujours place pour une amélioration continue et une plus grande transparence.
Selon toute vraisemblance, la question est de savoir quand, plutôt que si, des cadres réglementaires internationaux plus solides seront adoptés pour renforcer la surveillance des entreprises militaires et des prestataires de services de sécurité privés. Plutôt que d’attendre une nouvelle loi contraignante pour agir, le secteur de la sécurité et ses utilisateurs ont la possibilité de prendre de l’avance. Exiger des normes plus strictes dans les chaînes d’approvisionnement où les services de sécurité sont utilisés et au sein de l’industrie de la sécurité elle-même est une question de bon sens commercial et éthique. Il ne devrait pas être nécessaire de recourir à un instrument international pour que cela devienne réalité.